Historique de Marseille
| liens |
le 01/11/25
| ��L’actualité du LAM | ��Le cours à l’Observatoire Historique de Marseille |
| �� Mis à jour le 01/11/25 |
||||
| �� Spectre solaire | |||||||
Les spectres ci-dessous ont été photographiés le 17/02/2012 par L. Ruiz et J. Gispert, à l’aide d’un spectroscope Shelyak Lhires Lite, et d’une webcam Toucam Pro sans objectif. Un dispositif spécialement conçu, permettant de balayer régulièrement le spectre, a été apposé sur le spectroscope afin de produire des photos se chevauchant pour pouvoir les aligner.
Ces images brutes ont été rassemblées en séquences à l’aide de divers logiciels. Elles comportent des défauts horizontaux dus aux inévitables imperfections de la fente du spectroscope. Pour supprimer ces défauts instrumentaux, on peut sélectionner une ligne de pixels unique en dehors de ces défauts, et la dupliquer pour donner la hauteur de l’image définitive. Ce traitement donnerait un aspect un peu artificiel aux spectres, bien que ceux-ci soient de véritables photos.
Le choix d'une ligne de pixels unique ne permet pas de filtrer le bruit thermique de la caméra. Le traitement est donc amélioré en remplaçant cette ligne unique par la moyenne d'une colonne de pixels. Le bruit est ainsi considérablement diminué, et les images produites montrent toutes les raies détectables à l'œil dans les originaux, et peu d’artefacts (raies dues à du bruit, ne correspondant à rien de réel). La documentation d'un bien plus grand nombre de raies est possible. La partie entre 607 à 494 nm a été entièrement traitée à l'aide d'un logiciel écrit spécialement par l'auteur de ces pages.
La définition est de 104 pixels par nanomètre. 545 raies sont référencées.
La lumière émise par la photosphère du Soleil est privée de certaines couleurs lors de la traversée de la chromosphère et de la couronne. Ces couleurs manquantes se manifestent par les raies noires d’absorption.
Sur les spectres, les raies repérées sont désignées par le symbole chimique de l’élément qui les produit, ainsi que la longueur d’onde exprimée en nanomètres tronquées à deux décimales. Ces indications sont écrites en blanc.
La lumière qui a pu s’échapper sans encombres du Soleil doit encore traverser l’atmosphère de la Terre avant de nous parvenir au sol. Notre atmosphère est froide (par rapport à celle du Soleil), et contient de nombreuses molécules : O2, N2, H2O… On les nomme raies telluriques ou bandes telluriques (les bandes sont bien plus larges, produites par des molécules). Pour les distinguer des raies solaires, elle sont notées en rouge.
Parfois, des raies de deux éléments différents ont des longueurs d’onde très proches, et sont indicernables à la résolution de la photo. Dans ce cas, un même trait est utilisé pour reprérer toutes ces raies. Exemple : Ca 487,81 - Fe 487,82.
De nombreuses raies du fer sont notées, elles permettent en particulier de se repérer dans le spectre. Mais les raies du fer sont tellement nombreuses, qu’il est impossible de les repérer toutes…
Certaines raies faibles sont repérées, pour mettre en évidence certains éléments plus discrets, mais néanmoins présents.
Le rouge est à gauche, par conséquent les longueurs d’onde décroissent en allant vers la droite.

Cette partie du spectre ne contient pas de raies provenant du Soleil. Elle montre au contraire de nombreuses raies et bandes telluriques, essentiellement de la molécule O2. La série se termine vers la droite par une accumulation qui produit une bande.

La raie Hα de l’hydrogène (656,3 nm) correspond à la transition 3-2 des niveaux d’énergie. C’est la forte raie d’absorption visible ici au milieu de ce spectre. C’est elle qui produit la lumière de la chromosphère, et lui donne son nom. Elle est aussi responsable de la luminosité des nébuleuses excitées par des étoiles chaudes proches.
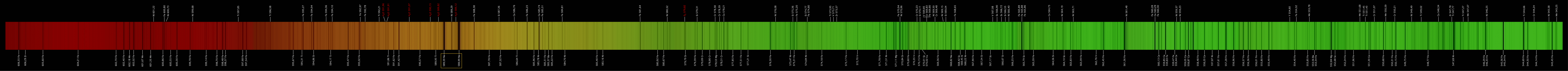
Le doublet du sodium est un grand classique des TP de spectroscopie. On le voit ici vers le centre droit de l’image. Il est constitué de deux raies très proches l’une de l’autre. Ces raies sont isolées dans le spectre du sodium, et sont prépondérantes. Lorsque le spectre est en émission, ce doublet très intense donne la coloration jaune-orangé à la lumière émise. C’est la couleur de nombreuses ampoules d’éclairage urbain, bien reconnaissable dans certaines rues. On obtient aussi cette couleur si on jette une petite pincée de sel fin dans une flamme.
Cette partie du spectre montre de nombreuses raies du fer, dont le spectre est très riche. Les plus importantes sont notées. On remarque un aspect cannelé du spectre. De nombreuses petites raies non référencées sont des raies telluriques de la vapeur d’eau.
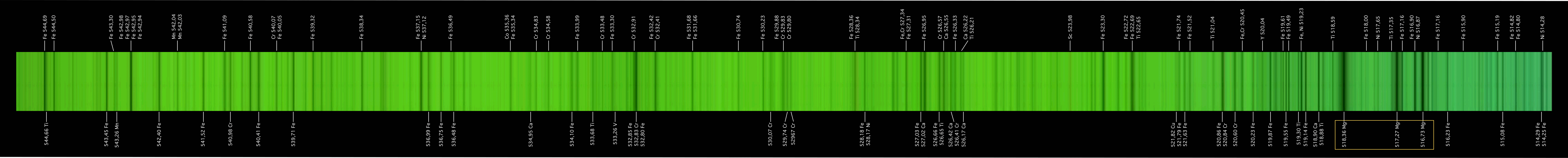
Le triplet du magnésium est constitué de trois raies proches, situées dans la partie verte du spectre. Il est caractéristique du magnésium. Il est situé dans une partie où se trouvent de nombreuses autres raies, provenant d’autres éléments. Le triplet est formé des trois raies bien noires situées à la droite de cette première photo. On a à gauche du triplet tout un ensemble de raies de provenances diverses.
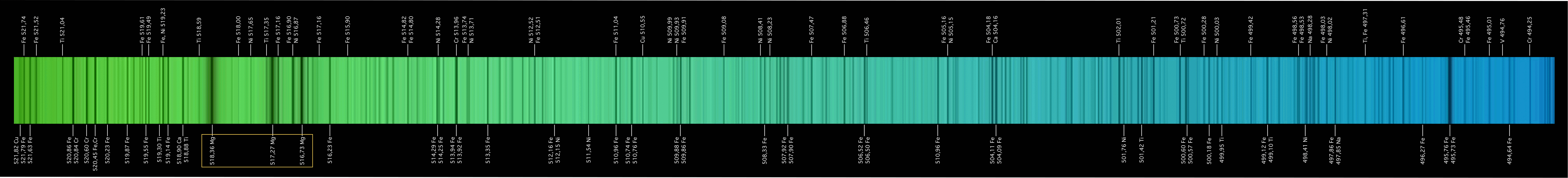
Cette dernière photo recoupe la précédente : on y retrouve le triplet du magnésium, situé cette fois à gauche.
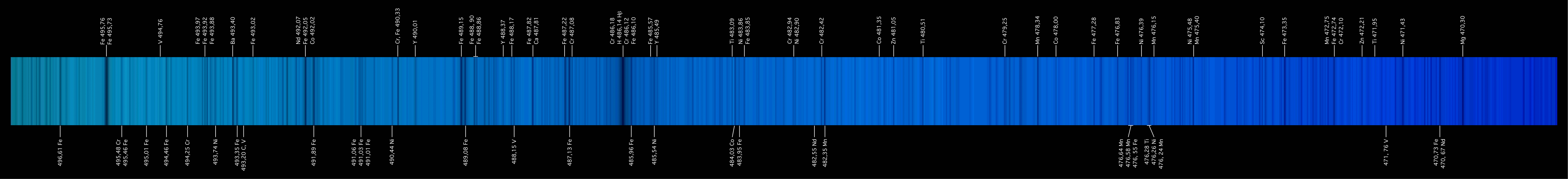
Cette photo recoupe aussi la précédente : c’est la partie bleue du spectre, en prolongement du triplet.

En observant ce spectre attentivement, on constate que beaucoup d’éléments n’y sont pas présents. Seraient-ils absents de l’atmosphère du Soleil ?
On peut remarquer autre chose encore en se limitant à un élément donné : le manganèse par exemple. On constate que les raies sont souvent groupées. Pourquoi ? Pour tenter une explication, pensons au spectre le plus simple, celui de l’hydrogène. Il est constitué de quelques séries, Lymann, Balmer, Paschen, Brackett, Pfund… Chacune de ces séries est basée sur un niveau d’énergie, et les raies sont produites par les transitions de l’électron entre un niveau supérieur et celui-ci. Or les niveaux sont d’autant plus proches les uns des autres qu’ils sont plus élevés. Par conséquent, les raies ont tendance à s’accumuler. D’autre part, les diverses séries sont globalement plus ou moins énergétiques : la série de Lymann est dans l’ultraviolet, celle de Balmer dans le visible (en partie au moins), les autres dans l’infrarouge. Pour les autres éléments, les choses sont plus complexes, mais les principes restent les mêmes, et conduisent à une certaine accumulation des raies dans certains domaines de longueurs d’onde.
Si un élément n’a pas de raies dans le visible, ou seulement des raies très faibles, il est tout à fait possible qu’il soit indétectable ici, tout en étant présent dans l’atmosphère du Soleil avec une abondance comparable à d’autres plus visibles ! C’est le cas de l’aluminium par exemple, dont les raies sont comprises entre 226,91 et 396,25 nm, donc dans l’infrarouge jusqu’à la limite inférieure du visible. Pour détecter ces éléments dans l’atmosphère du Soleil, il faut donc étendre le spectre aux domaines limitrophes du visible, l’infrarouge et l’ultraviolet.
L’identification des raies spectrales a été faite à l’aide d’un spectre du Soleil donné par l’Observatoire de Paris-Meudon sous forme de courbe (solar_spect.pdf), et du livre "Tables of Spectral-Line Intensities", de W.F. Meggers & al., National Bureau of Standards Monograph 32.
---=OO=---